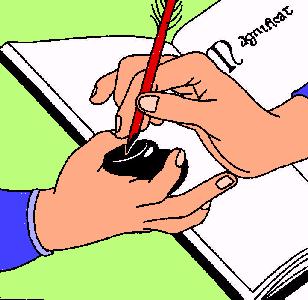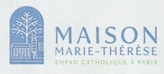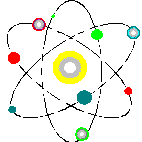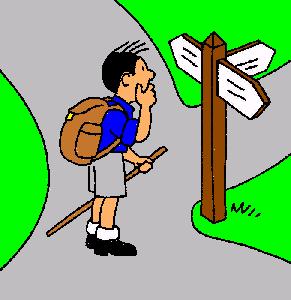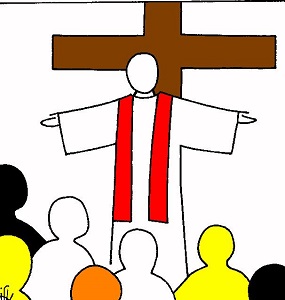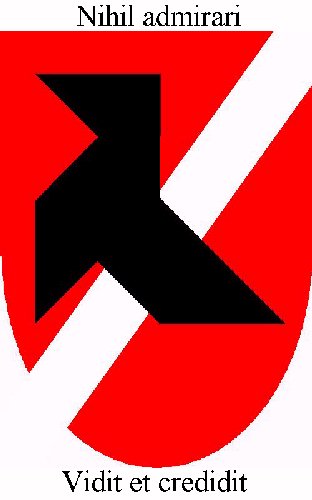15 juin 1991

Saint Charles de Monceau
retour en haut de la page
n°14
|
Les paraboles du Royaume
Les mots roi, royauté, royaume sont évidemment d'usage
courant chez les Juifs qui avaient connu le régime monarchique
depuis le XIème siècle avant Jésus-Christ jusqu'à
l'Exil à Babylone au VIème siècle avant Jésus-Christ.
Mais la Bible, dès les origines, leur donne un sens religieux en
affirmant constamment que Dieu est roi, qu'il doit régner, qu'il
est seul vraiment roi. Maître de l'univers qu'il a créé,
Dieu est le chef du Peuple d'Israël avec lequel il a passé
alliance : il le protège, il le conduit par ses prophètes;
il le punit de ses infidélités pour le remettre sur le bon
chemin.
Les rois que se donne Israël ne sont que ses lieutenants; ils n'ont
aucun caractère divin, quand bien même ils reçoivent
l'onction qui les consacre. L'infidélité de ces rois conduira
d'ailleurs la dynastie de David à sa disparition, et, après
l'Exil, c'est par ses prêtres et ses prophètes que Dieu gouverne
désormais Israël.
Le Peuple d'Israël n'en continue pas moins à espérer
un avenir où Dieu règnera véritablement sur l'univers
(cf. Ps 47 et 96). Grâce au roi-messie qu'il consacrera, ou même
sans cet intermédiaire, le règne de Dieu est au cœur de
l'attente des croyants, au temps de Jésus.
On comprend bien dès lors pourquoi Jésus inaugure son annonce
du salut en proclamant la proximité du Royaume de Dieu (ou du Royaume
des cieux, ce qui revient au même). Il déclare même
que le Royaume est déjà là (Mt 11,2-6,12,28; Lc 16,16).
Non pas de manière éclatante, et encore moins par une restauration
politique (Jn 18,36), mais par une vie nouvelle, une vie spirituelle,
dont la semence est déposée au cœur de l'homme (Mt 13,24-43).
Ce Royaume va grandir jusqu'à son achèvement, lorsque le
Christ remettra à Dieu son Père le Royaume de l'humanité
sauvée (1Cor 15,24-28).
L'Eglise fondée par Jésus ne s'identifie pas totalement
à ce Royaume, mais elle en est l'ébauche visible, le chantier
de construction inachevé mais en pleine activité.
Les Paraboles du Royaume n'ont pour but que d'exprimer cette conception
théorique par des exemples pratiques dont nous n'avons pas fini
d'explorer la richesse.
Père JeanPaul BOUVIER
vicaire à saint Charles de Monceau
|
17 juin 2012

Fort Neuf de Vincennes
retour en haut de la page
n°620
|
Apparaître à découvert
Lorsque saint Paul écrit aux Corinthiens que nous devrons tous ‘apparaître
à découvert devant le Seigneur’ (5,10) il ne profère pas une menace
mais une espérance. Pharisien formé par le rabbin Gamaliel (cf. Actes
22,3) reconnu pour la qualité de son enseignement, il fait allusion au
paradis perdu au moment où le premier couple est créé : « tous
deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un
devant l'autre. » (Genèse 2,25) La nudité dont il est question
n’est pas la simple absence de vêtements, c’est aussi la nudité spirituelle :
ils n’ont rien à cacher l’un envers l’autre… ni à Dieu ! Dès qu’ils
ont commis l’acte de désobéissance, ils veulent le cacher de Dieu derrière
un pagne de feuilles de figuier (Genèse 3,7)
Ainsi saint Paul en sous-entendant ce récit biblique rappelle implicitement
aux chrétiens de Corinthe que le Paradis est à nouveau ouvert pour les
hommes et femmes qui se présenteront au ‘à découvert au tribunal du
Christ’ dans la nudité spirituelle, sans rien avoir à cacher ni avoir
honte devant le Sauveur. Restaurés dans la pureté originelle de la Création
par le Sacrifice du Christ, les chrétiens peuvent s’avancer sans crainte,
en toute confiance, vers le Seigneur ; leur vie parle pour eux et
ils se présentent tels qu’ils sont.
Cette lecture retentit encore davantage dans notre époque qui a multiplié
les sources de tentations : le temps passe trop vite et nous remettons
à plus tard l’intimité que nous devrions avoir avec le Seigneur ;
elle conditionne pourtant l’annonce de l’Evangile qui est ainsi reléguée
à un plan subalterne. L’éducation chrétienne des enfants nécessaire pour
leur future vie de chrétiens adultes passe après les occupations de loisirs
que nous nous sentons obligés de devoir leur donner. L’approfondissement
de notre foi d’adulte est négligé et nous la laissons aller sur sa lancée
sans nous apercevoir de son affaiblissement.
« Notre ambition c’est de plaire au Seigneur. » (2Corinthiens
5,9) écrit sans Paul. Qu’en est-il de la nôtre ? Chaque dimanche
les lectures nous provoquent à changer de vie, à nos convertir pour nous
retourner l’essentiel : l’amour de Dieu et du prochain. Les résolutions
ne suffisent pas, elles doivent être suivies d’actes concrets. « Rejetez-vous
le péché ? » demande-t-on lors du Baptême et tous les assistants
répondent : « J’y renonce ! » que ce ne soit
pas dans notre vie une simple formule liturgique mais une affirmation
de tous les jours.
Père JeanPaul Bouvier
Aumônier du Fort Neuf de Vincennes
|
17 juin 2018
 
Paroisses Nesle & Athies
Retour en haut de la page
n°1017
|
Profession de foi
Le mois de juin et propice pour les célébrations de ‘profession de
foi’, c'est-à-dire qu’il est demandé au jeune préadolescent de prendre
à son compte l’engagement qui a été fait en son nom .par son parrain,
sa marraine et ses parents le jour de son Baptême. Il est bon de revenir
sur l’origine de cette étape de la vie chrétienne.
Au début du XXème siècle, pour la plupart les jeunes arrêtaient
à la fin de l’école par le Certificat d’études, ils devenaient adultes
et commençaient à travailler. L’habitude avait été prise que cela corresponde
à la première communion : ils entraient dans la communauté chrétienne
comme dans le monde actif.
Saint Pie X (1903-1914) a voulu que les plus jeunes ne soient pas privés
de la grâce de la communion alors qu’ils vont à la messe tous les dimanches ;
il a proposé de les faire communier à partir de l’âge de 7 ans. Mais le
rite de passage a été conservé en France, il y a donc eu une communion
‘privée’ avec quelques intimes et une communion ‘solennelle’
source d’une fête de famille. Pour les garçons, c’était le premier pantalon
long, la première montre, la première cigarette et le premier verre d’alcool !
Pour les filles une robe équivalente à une robe de mariée était confectionnée.
A partir de ce moment, ils pouvaient se servir eux-mêmes à table :
ils étaient adultes.
A la suite du Concile Vatican II, l’Eglise de France a voulu marquer
que toute communion est privée par la réception personnelle du Corps du
Christ mais elle est aussi solennelle par la grâce qui est donnée. Mais
la fête de famille était profondément ancrée dans les mœurs ! L’Eglise
a alors proposé une fête de la foi où la valorisation du Baptême reçu
dans la petite enfance sera première.
La componction avec laquelle ces jeunes professent la foi devant nous
ravive notre propre relation à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. La récitation
commune que nous faisons des symboles des Apôtres ou de Nicée-Constantinople
n’est-elle pas trop souvent ânonnée distraitement, tout en cherchant la
piécette à mettre à la quête ? La joie qui s’exprime sur le visage
de ces jeunes est-elle aussi la nôtre ?
La profession de foi dominicale vient après les lectures et l’homélie,
les compagnons d’Emmaüs constatent : « Notre cœur n’était-il
pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait
les Écritures ? » (Luc 24,32). C’est avec un cœur brûlant
et à pleine voix que nous devons proclamer : « Je crois en
Dieu ! »
Père JeanPaul Bouvier
Curé de la Paroisse Notre Dame de Nesle
& modérateur de la Paroisse sainte Radegonde
|
16 juin 2024
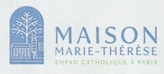
Maison Marie-Thérèse
Retour en haut de la page
n°1390
|
Dieu sème la Parole
« Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre, »
(Genèse 1,1) Pour créer l’univers, Dieu sema la Parole : « Dieu
dit… et cela fut. » Le germe ainsi lancé, le monde a pu se développer
suivant la volonté du Seigneur : « D’elle-même, la terre
produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. »
(Marc 4,28)
Ainsi en est-il pour tous les êtres humains : le Seigneur a mis
en eux son Souffle, l’Esprit Saint, et comme pour la semence, nuit et
jour, cet Esprit les travaille pour qu’ils puissent être des hommes et
des femmes debout, sans entraves, libres devant la vie. L’évangéliste
a déjà précisé dans l’explication que Jésus a donnée à ses Apôtres de
l’autre parabole du semeur : « Le semeur sème la Parole »
(Marc 4,14) Lorsque la Parole trouve en l’homme une écoute favorable,
il n’a de cesse que de la répandre ; comme l’épi ne peut retenir
en son sein les grains de blé, le chrétien ne peut retenir cette force
de l’Esprit Saint qui lui permet d’annoncer avec saint Paul : « Que
toute langue proclame : Jésus Christ est Seigneur » à la gloire
de Dieu le Père. » (Philippiens 2,11)
L’agriculteur ne travaille pas au hasard, il étudie les différents éléments,
la terre, le climat, l’ensoleillement, les besoins de la population… Suivant
cette analyse il sème du blé ou de la moutarde, la récolte sera différente
mais c’est toujours le résultat de son travail. Dans le cas de la Parole
de Dieu, elle sera toujours animée par l’Esprit. Ainsi chaque chrétien
transmettra la Parole en fonction de ce qu’il est, le Seigneur suscitera
selon les époques les personnes dont l’Eglise a besoin. Saint Paul l’affirmait
lorsqu’il écrivait : « Les dons de la grâce sont variés,
mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même
Seigneur » (1Corinthiens 12,4-5)
Chaque homme, chaque femme a sa place dans le monde et est appelé à être
témoin de l’amour de Dieu. Les chrétiens sont nourris par la Parole du
Seigneur qui est semée en eux. Par ses paraboles le Christ demande qu’elle
s’épanouisse en nous et que nous la laissions nous guider sur le chemin
qui mène à Dieu. Il ne nous demande qu’à être nous-mêmes avec nos propres
qualités et nos propres défauts : une semence de moutarde ne donnera
jamais un épi, l’Esprit met en nous une façon de proclamer l’Evangile,
il nous donne aussi les moyens pour le faire.
« Confiance, lève-toi, il t’appelle » dit-on à l’aveugle
de Jéricho (cf. Marc 10,49) Comme cet homme nous ne savons pas à quelle
mission le Seigneur nous appelle à accomplir, mais comme lui, l’aveugle
qui se met à courir nous savons que les obstacles seront facilement franchis
avec l’aide de Dieu. Nous pourrons avancer avec le Christ et témoigner
avec fermeté de notre expérience de la Parole et de l’amour de Dieu.
Père JeanPaul Bouvier
Prêtre retraité – curé émérite
|